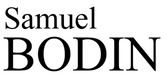Article publié sur le site internet de la revue Front Populaire le 12/11/2022
La pluie redouble d’efforts, je me tiens debout, le dos tourné aux rafales de vent. Je sens l’eau ruisseler le long de ma nuque. Mon pull ne tarde pas à être détrempé. Face à moi se tient Jérôme, un maraîcher à qui j’apporte les restes de céréales devenues inutiles pour moi. Son visage est enfoui dans son imperméable, seules ses lunettes aux verres ronds dépassent. Elles sont recouvertes de pluie. Malgré le temps exécrable, nous discutons. Je peste contre ce déluge impromptu, lui l’encense et on peut le comprendre après un été de sécheresse : je les ai vus sous le soleil de plomb, son associé Pierre et lui, s’activer pour tenter vainement de soulager des légumes en souffrance.
Pierre et Jérôme sont complémentaires parce que de caractères opposés : le premier est taciturne, discret, pragmatique quand le second est plus loquace, ouvert, créatif. Ce sont deux maraîchers somme toute encore jeunes ; je miserai en dessous de la quarantaine ; comme moi, à moins que je ne sois trompé par la propension naturelle que nous avons en vieillissant à ne plus voir sur les visages l’apparition des rides. Pierre et Jérôme cultivent des légumes bio. Ils ont une petite surface qu’ils investissent peu à peu au fil des années. Cette année, j’ai ainsi assisté à l’apparition des premiers arbres fruitiers. Pour le moment, ils ressemblent davantage à de chétifs arbrisseaux. Il faudra patienter de longues années pour qu’ils deviennent productifs.
Jérôme m’explique avoir beaucoup travaillé pour faire grandir le potager. Trois années d’efforts, de travail musculaire par tous temps, qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’il fasse un froid hivernal ou un soleil écrasant, en semaine ou pendant les weekends. Il a donné sans compter, sans retenue, abîmant son corps probablement trop chétif pour un tel métier. Je ne dis pas cela avec mépris, bien au contraire : chaque semaine j’ai pu le trouver ici accroupi, là penché, mais toujours à travailler, encore et encore. Je ressens aussi sur mon propre corps les traces d’un métier physiquement exigeant. Je devine donc les blessures silencieuses que porte Jérôme. Il est là face à moi et il m’explique qu’il arrêtera à la fin de l’année. Il en a marre. Il est au bout du rouleau, il jette l’éponge.
Trois années à ne rien gagner, pas un centime, rien ! Il dit cela résigné, je le décèle au changement subit du timbre de voix. L’émotion est là, secouant les entrailles, mais il reste impassible ou presque. Seule une imperceptible moue qui se dessine au loin sous l’énorme capuche de son imper le trahit.
Jérôme renonce, il abdique : il n’est pas masochiste, il veut bien sacrifier nombre de plaisirs à l’autel d’un métier passion, mais il y a des limites à tout. Il m’explique ne plus avoir de weekends, de très rares vacances, une enfant qu’il ne voit par conséquent que de façon fugace, idem pour une compagne qu’il ne côtoie qu’épuisé physiquement, enfoncé qu’il est dans son corps exténué, somnolant, cassé par l’effort, tout juste bon à se traîner jusqu’au lit pour dormir d’un sommeil de plomb. Il me raconte tout cela et plus encore : les engagements pris par des associations de particuliers qui ne sont pas honorés, les légumes qui s’accumulent et qu’ils peinent à écouler, courant d’un marché à l’autre.
Je me souviens, au printemps, toutes les peines du monde qu’ils avaient à sortir de terre les premiers légumes, tant l’hiver fut rude, je les ai ensuite vus se battre contre la sécheresse et lorsqu’enfin le travail paya, les gens se débinèrent, trop contents de partir en vacances pour anticiper qu’ils ne pourraient pas tenir l’engagement pris initialement d’acheter les légumes. J’écoute donc ses explications : pas une complainte, mais bien plus une liste de raisons qu’il s’adresse à lui-même pour s’extirper un sentiment de culpabilité. Je ressens toute la difficulté qu’il éprouve à partir et à laisser Pierre seul.
La fois suivante, il me confiera ajouter à son départ un divorce. Je me suis bien gardé de le questionner sur les raisons d’un tel évènement. Il y a des pudeurs que ni lui ni moi ne franchirons. Il me dira toute la difficulté de se reloger dans notre coin : depuis l’arrivée du TGV en ligne directe depuis Paris, les prix de l’immobilier se sont envolés. Il a voulu regarder le prix des loyers, juste comme ça pour voir, il en est resté abasourdi. En une décennie les prix sont devenus inabordables. Par chance, il ne quittera pas son métier de maraîcher sans rien retrouver derrière, il a décroché un CDI ailleurs. Cela devrait normalement suffire à garantir un toit sur la tête : un salaire pour se loger et se nourrir décemment. Pas ici, pour espérer la dignité, il faut un salaire qui est inaccessible pour lui comme pour moi. Pourtant il ne visait pas autre chose qu’un petit deux-pièces pour recevoir sa fille.
Nous évoquons les logements sociaux, ces habitations à loyers modérés prévues pour ce genre de situation. Il m’avoue hésiter à y faire appel : une de ses amies ayant connu une rupture brutale a fini par être logée dans un logement social. L’appartement était propre, bien agencé, mais son amie a déchanté lorsqu’il lui fut recommandé de ne pas aller dans la cave de l’immeuble, trop risqué, lui a-t-on dit. Il m’explique que son amie peut voir du haut de sa fenêtre du trafic de drogue ainsi que des rodéos urbains. Je croyais pourtant le quartier paisible. Apparemment, les choses ont rapidement changé.
Je dis à Jérôme qu’il ne faut pas se leurrer, il peut tout de même faire une demande de logement social, le temps d’attente avant d’espérer une première proposition est d’au moins trois années, souvent plus, beaucoup plus. Je remonte dans ma camionnette, je manœuvre pour éviter soigneusement les jeunes arbres — l’autre jour, j’en ai esquinté un en reculant, l’esprit probablement empêtré dans mes tracas —, je franchis le portail et repars. Sur la route alors que je songe à notre conversation, je ne peux me débarrasser d’une désagréable sensation d’abandon.
Au volant de ma camionnette, je réfléchis aux mots de Jérôme. Je médite aussi sa décision radicale de tout quitter. La vue des véhicules immobilisés sur la route en sens inverse parce que trop nombreux me rappelle son amer constat : le prix de l’immobilier est trop élevé pour espérer se loger en ville ou dans les alentours. Alors chaque matin, quantité de travailleurs modestes font le trajet depuis leur lieu de résidence à plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre à leur travail. Ils sont là, au volant de leur véhicule et peut-être songent-ils, à l’heure de la hausse continue des prix des carburants, à la perte d’argent et de temps que représentent ces trajets. Ils se questionnent, sûrement, eux aussi, quant à l’absurdité d’un système qui multiplie les complications pour un maigre bénéfice : une habitation onéreuse excentrée et donc éloignée de toutes les commodités habituelles, je songe aux écoles, aux commerces, à l’accès aux soins ou même à la culture, mais aussi la longueur des trajets pour un coût toujours plus important. Enfin, l’emploi occupé, souvent mal rémunéré, sinon tous ces automobilistes vivraient plus près de leur emploi, plus près des écoles, des commerces, des hôpitaux, des cinémas, des théâtres, des bibliothèques, des musées ; l’emploi mal rémunéré donc, quand il n’est pas morcelé pour fragmenter la journée du travailleur par de longues coupures ; c’est le cas des employés de la restauration qui travaillent en fin de matinée jusqu’au début d’après-midi lorsque le service du déjeuner est terminé. Ils reprendront plus tard, pour le service du soir. Quid du trajet trop long, trop cher ? Que font-ils ? Quels choix ont-ils ? Restent-ils sur place ? Repartent-ils malgré tout chez eux ? Je m’interroge en voyant derrière les pare-brises les visages fatigués de ce lumpenprolétariat. Je pense à eux, je pense à Jérôme, je pense à nous, à une facture de l’un de nos clients, restée impayée, une somme importante, dont le sort va se jouer dans les jours qui viennent, l’huissier tentant une dernière saisie sur un compte bancaire du débiteur avant que les autres créanciers, prioritaires sur nous (notamment des bailleurs) ne raflent ce qu’il reste du commerce endetté. Je sens cette poigne me nouer le ventre, mes entrailles me brûler de l’intérieur : un feu interne me consume et à l’évidence cette ambiance générale mortifère, ce contexte particulier de crise économique n’améliore pas une biologie déjà bancale.
J’aime chasser les ténèbres par la remémoration des sages antiques. Je laisse divaguer mon esprit à la rencontre de Diogène de Sinope, si bien raconté par Michel Onfray. Je délaisse la fraîcheur des tristes matins d’automne pour me transporter dans la quiétude de la Grèce. J’imagine Diogène, chichement vêtu, marchant avec son bâton le long d’un sentier de cailloux. La chaleur lui brûle les joues, la nature s’exprime autour de lui, généreuse et bruyante. Diogène n’en perd pas une miette, il jouit de l’existence pour ce qu’elle est, dans l’instant présent, libéré de toutes les chaînes de la nécessité. Voilà qu’il a soif, il lui suffit de trouver une fontaine ou un maigre ruisseau, de se pencher au-dessus de l’eau claire et d’y plonger la main. Diogène célèbre le dépouillement en ce qu’il évite la frustration. Il ne refuse pas le plaisir, loin de là, mais préfère toujours un plaisir immédiat à un plaisir futur, un plaisir gratuit à un plaisir coûteux, un plaisir simple à un plaisir extravagant. L’objectif demeure identique en toute circonstance : éviter la frustration, source de déplaisir et préférer le plaisir simple et rare, voie royale vers le bonheur.
La crise économique est une occasion idéale pour penser en héritier de Diogène. Les rêves de réussite économique s’éloignent, laissant la perspective d’un salaire décent assez incertaine. En cascade disparaît la possibilité d’un logement adapté, d’une alimentation choisie plutôt que contrainte par la réalité du porte-monnaie. La crise économique signe également le recul d’un choix plus souple pour se vêtir, pour choisir les activités des enfants, pour la sélection des cadeaux, pour la possibilité d’une sortie culturelle ou simplement ludique, c’est enfin le retour d’une gestion millimétrée des comptes bancaires, des lignes des tableurs Excel pour connaître avec précision l’actualité du budget et donc les choix envisageables ou non. En somme, la crise économique sonne le retour d’un passé de précarité fui.
Là encore, la vie simple et modeste, cette sobriété vertueuse clamée par Emmanuelle Macron est une réalité pour des millions de Français depuis longtemps, seulement, le chef d’État qui ignore ce qu’est le réel de ses concitoyens, pense prôner une doctrine novatrice. L’écroulement généralisé de la société depuis des décennies a forgé une classe populaire au moule de l’austérité. Les gens se débrouillent, ils vivent simplement non par choix, mais parce qu’ils y sont contraints économiquement. L’inflation, la hausse des prix des carburants et désormais de l’énergie va faire tomber quantité d’individus dans la véritable détresse. Seulement, ils appliqueront en silence encore davantage l’enseignement des sages antiques pour sauvegarder leur dignité, seule richesse qu’on ne leur a pas encore retirée.
Il subsistait ici ou là quelque menu plaisir ? Il ne faudra plus y songer, ce qui n’est pas plus mal, car la petite soirée en couple après avoir laissé les enfants aux grands-parents pour aller souffler loin du train-train quotidien devient insupportable : en déambulant dans le centre-ville, les inégalités sont flagrantes, elles sont également indécentes. Nous voyons, attablés aux meilleurs restaurants, ceux pour qui la crise n’existe pas. Il vaut mieux bifurquer, tourner au coin de la rue pour remonter le long de la mer silencieuse et ainsi admirer le spectacle éternel du soleil qui se couche. Pour ceux d’entre nous qui seraient trop blessés dans leur amour-propre par un tel déballage d’inégalités sociales, les sorties seront donc désormais bannies.
Il demeure le cœur névralgique de l’existence, la vie pour ce qu’elle représente en soi, un bonheur à seulement être au monde. Il y a les sourires, les rires, les enfants, l’amour, l’amitié, la passion, ici pour la musique, là pour l’écriture, toutes ces choses qui nous sont encore accessibles gratuitement et que l’on a vues menacées pendant le Covid-19.
L’argent ne sera probablement pas au rendez-vous des temps prochains ? Ne nous mentons pas, c’est une catastrophe, source d’angoisse et d’un incendie interne difficile à contenir, mais il faudra dépasser cet état de fait. Il faudra surmonter parce qu’il n’y a pas d’autre choix. En bon nietzschéen comment refuser le combat puisque vivre c’est se battre. Voilà pourquoi la transmission de la pensée matérialiste et existentielle par Michel Onfray est vitale, pourquoi elle demeure une bouée salutaire dans une époque qui préfère s’exciter sur des sujets fumeux. Dans les ténèbres, il faut une lanterne pour guider les pas, il faut trouver les mots qui réconfortent, les décisions qui sauvent, les actes qui protègent.
Je regarde une dernière fois dans le rétroviseur les feux arrière des voitures s’éloigner et je me promets de partager les soubresauts d’un esprit agité par des temps difficiles.