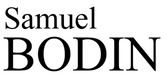Texte publié sur le site internet de la revue Front Populaire le 19/06/2022
Après une journée de travail dans le froid, je rentre chez moi au volant de mon fourgon. Au loin décline déjà le terne soleil hivernal. La route est rectiligne, elle est encombrée d’une file de véhicules qui se suivent pour ramener chacun dans la chaleur du domicile familial. De part et d’autre de la route s’étalent les champs désertiques, un horizon de terres nues attendant patiemment le retour du printemps synonyme de semis. Il y a bien ici et là quelques arbres qui ont survécu à la folle entreprise d’exploitation du moindre mètre carré de terre arable. Je parcours le chemin matin et soir, quelques fois le midi aussi. Je n’y prête plus vraiment attention.
Je songe aux problématiques d’une entreprise naissante, une petite brasserie artisanale de trois années, à tous les tracas du quotidien, des mille choses à penser, à faire, à anticiper. À la montagne de paperasse à remplir, aux commandes à préparer, bref à toutes ces choses qui sont propres à chaque métier, mais que chacun connaît.
Mais ce jour-là, je repère sur le bas-côté un rapace. Il se tient sur ses pattes, le long de la route et observe le ballet des véhicules. Il s’agit probablement d’une buse, un animal au plumage élégant. L’oiseau est la seule âme qui vive en dehors des conducteurs. Il scrute la route, peut-être à la recherche d’un animal bousculé par une voiture et dont le corps inerte servirait de repas. Je suis frappé par le contraste de la noblesse du rapace, son air majestueux, sa taille relativement imposante et la sensation contradictoire d’une extrême fragilité de l’animal, lui qui erre dangereusement à côté des monstres d’aciers lancés à vive allure.
L’oiseau est immobile, patient, stoïque, pourrait-on presque dire. Il est une des composantes d’une nature immuable, qui suit une rythmique propre, étrangère à l’agitation frénétique des humains. Je pense à son combat du quotidien pour se nourrir, à la précarité d’une existence entièrement vouée à la survie. Je m’interroge sur mon propre sort, à la relativité du sentiment de pérennité de nos propres vies. La longévité n’a rien d’acquis, la vie demeure frêle et fragile, comme celle de l’oiseau. Les trois cachets que je prends tous les matins pour endiguer un corps qui s’agresse lui-même en sont la plus frappante illustration. La faute à une maladie auto-immune, a dit le médecin il y a de cela un peu plus de cinq ans, alors que j’étais dans un piteux état. Depuis, la médecine moderne, par ces trois petites gélules bleues, aura réussi l’exploit de rétablir l’équilibre. La tempête d’un corps qui se déchaîne contre lui-même, s’agresse et se blesse a fini par s’apaiser. S’il n’y avait pas le rituel de la prise quotidienne des médicaments, je pourrais presque oublier la maladie, un mal invisible à l’œil, mais dont les effets, eux, lorsque le mal se réveille, sont bien visibles.
Depuis ce jour, j’ai pris conscience de la fragilité de la vie, chassant le naïf sentiment d’invulnérabilité de la jeunesse. Je pense à ces philosophes qui ont su témoigner du feu incandescent que représente l’existence, Nietzsche avec le grand oui à la vie, à l’idée de la grande santé, on peut le comprendre puisque justement la santé lui aura fait défaut tout au long de sa vie. Albert Camus et le soleil de midi, une intensité de l’existence renforcée par la découverte à dix-sept ans d’une tuberculose. Enfin, Michel Onfray, libertaire qui produit une œuvre colossale, peut-être poussé par le moteur que l’existence n’est qu’un répit en attendant que la mère Nature ne siffle la fin de partie. Et on le comprend puisqu’il a survécu à un infarctus et deux AVC.
J’ai en tête le poème de Dylan Thomas :
N’entre pas sans violence dans cette bonne nuit,
Le vieil âge devrait brûler et s’emporter à la chute du jour ;
Rager, s’enrager contre la mort de la lumière.
Bien que les hommes sages à leur fin sachent que l’obscur est mérité,
Parce que leurs paroles n’ont fourché nul éclair
Ils n’entrent pas sans violence dans cette bonne nuit.
Les hommes bons, passée la dernière vague, criant combien clairs
Leurs actes frêles auraient pu danser en un verre baie
Ragent, s’enragent contre la mort de la lumière.
Les hommes violents qui prient et chantèrent le soleil en plein vol,
Et apprenant, trop tard, qu’ils l’ont affligé dans sa course,
N’entrent pas sans violence dans cette bonne nuit.
Les hommes graves, près de mourir, qui voient de vue aveuglante
Que leurs yeux aveugles pourraient briller comme météores et s’égayer,
Ragent, s’enragent contre la mort de la lumière.
Et toi, mon père, ici sur la triste élévation
Maudis, bénis-moi à présent avec tes larmes violentes, je t’en prie.
N’entre pas sans violence dans cette bonne nuit.
Rage, enrage contre la mort de la lumière.
Dylan Thomas a raison. L’existence n’est qu’une bataille de la vie contre la mort, l’une n’existe qu’en regard de l’autre. Comme le rapace sur le bord de la route, tranquille, mais pourtant luttant avec férocité pour vivre. Il se bat et refuse la lumière qui menace de vaciller. Il y a donc urgence à vivre, à jouir intensément de l’existence, car rien n’est éternel. Toutes ces déclarations de bonnes intentions ont été maintes fois dites et redites, pourtant elles méritent plus que des mots, elles exigent d’agir en conséquence.
Je laisse le rapace derrière moi, je le verrais encore par deux fois cette semaine sur le bord de la route.